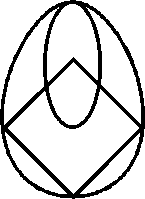
Je suis accompagnée à l'hôpital Sainte Anne, la décision du psychiatre étant sans appel : l’internement, et tout de suite !
Etiquetée: bouffée délirante de type maniaque.
Je suis dans un état d’écoeurement et de violence non contenue. Je ne me sens pas "folle". Il me semble que je vois des choses que d’autres ne voient pas. Je ne suis plus dans cet état d’euphorie et de légèreté.
A Sainte Anne, dans le couloir, je passe devant une porte ouverte où une personne est attachée par d’énormes bracelets en fer qui lui encerclent les pieds et les mains, les maintenant au lit.
J’attends le psychiatre pendant une heure et demi environ. Après l’entretien, le verdict est confirmé "Psychose maniaco-dépressive", avec excès maniaque dans l’immédiat.
On me domicilie chez ma tante, afin de pouvoir déterminer où je serai internée. La logique de l’administration psychiatrique est imbattable ("une histoire de fous") : ce sera à Perray- Vaucluse, c’est à dire à l’opposé de son lieu d’habitation, dans le XVIIIème arrondissement. La majorité des personnes domiciliées dans cet arrondissement, qui sont internées, le sont à Perray-Vaucluse. Inversement, les gens habitant au sud de Paris, lorsqu'ils sont envoyés à l'hôpital, vont dans un établissement qui se situe au nord de la capitale. Il faut donc traverser tout Paris pour qu’un proche vienne en visite.
Une ambulance m’emmène vers cet hôpital.
Je ne peux m’empêcher de penser au pouvoir abusif de ce psychiatre, sous prétexte que ce que je perçois ne correspond pas à sa norme et à celle plus globale de la société.
Nous traversons des bois somptueux, avant de se retrouver devant un pavillon sinistre, comme tant d’autres aux alentours.
Un long couloir éclairé au néon répand une lumière verdâtre. La porte de sortie est tout de suite fermée derrière moi. On me fait entrer dans un bureau où l’on pose toutes les questions de type administratif. Après cet épisode, on me désigne une chambre. Une infirmière au sourire forcé arrive peu après, me tendant un gobelet en plastique rempli d’un breuvage jaune.
Je demande ce que c’est. Elle me répond qu’il s’agit de Tersian. Je refuse de le boire. Prenant un air pincé, elle me rétorque :
- "C’est ça ou la piqûre ! Et la piqûre c’est pire; ça assomme plus."
Je bois à contre coeur ce médicament au goût amer. Tout de suite après, on m’apporte un pyjama bleu et l’on décide de m’ôter la possession de mes vêtements. Je réussis à garder mon blouson, mon écharpe et mes chaussures, prétextant une sensation de froid. Ce qui est faux puisque les accès maniaques ont tendance à donner des impressions de chaleur (en partie dues à l’agitation).
Des personnes, qui de toute évidence sont abruties de médicaments, déambulent. La plupart d’entre elles font des allées et venues dans le couloir, en fumant, le plus souvent. Les autres sont assises sur les radiateurs de la grande salle. La plupart sont silencieuses. Une femme au corps déformé, assise dans un fauteuil roulant, chantonne systématiquement le même air en dodelinant de la tête et en fixant l’écran de télévision.
Lorsque je pénètre pour la première fois dans cette pièce, une grande partie des patients me fixe avec attention, tout en gardant leur distance. Je suis, cependant, accueillie par un homme d’une cinquantaine d’années, Robert, qui me souhaite la bienvenue. Manuel, un portugais d’une vingtaine d’années, m’informe tout de suite qu’avant d’être enfermé et qu’on lui donne des médicaments, il était très fort en Aïkido.
A vingt deux heures, on nous somme de nous coucher. Chacun, dans le silence, regagne sa chambre. Les médicaments produisent un effet radical, et je plonge dans un sommeil qui n'avait pas été aussi long depuis longtemps.
Tant que le Tersian ne produit pas son effet, je suis très agressive et ceci surtout depuis mon internement. Je signale aux infirmiers qu’au lieu de regarder la télévision dans leur salle et d’administrer des doses massives de médicaments, ils feraient mieux de s’occuper intelligemment des patients. Aussitôt on me rétorque :
- "Mademoiselle Ouldhacene, si vous ne vous calmez pas, c’est la piqûre, et d’office !"
Ils n’ont que le mot piqûre à la bouche, c’est leur protection, leur rempart à tout dérapage dans leur semi-tranquilité.
Je suis assommée de Tersian trois fois par jour. Je marche à la manière d’un zombie et prend du poids d’une façon visible, alors que mon estomac rétréci refuse presque toute nourriture.
Par ailleurs, cette pharmacopée rend amnésique. Les personnes qui m’entourent sont souvent boursouflées, se plaignent de maux de ventre, de constipation et de bouche sèche.
La grande salle ressemble étrangement à celle du film "Vol au-dessus d’un nid de coucou".
L’heure de la prise des médicaments et des repas rythme le temps. Elle est scandée par une sonnerie stridente. A ce signal, tout le monde se regroupe dans la grande salle. Le couvert y est posé par trois volontaires. Le chariot jonché de médecines diverses est poussé par une infirmière. Chacun s’installe autour, attendant sa drogue, sans un mot. Les patients ne pouvant se déplacer seuls, pour des raisons physiques ou psychiques, sont amenés directement à leur table ou on leur donne directement leur dose. Chacun regagne sa place.
La télévision, perpétuellement branchée sur TF1, est éteinte.
Des barquettes en carton sont apportées par des infirmières, qui servent tout le monde.
Quant il n’y a pas de rares altercations ente deux personnes, le seul bruit du repas est celui des couverts. Ensuite, chacun débarrasse son assiette, et les trois responsables s’occupent de la vaisselle.
Toutes les semaines, des réunions sont fixées avec la plupart des patients, pour inscrire le nom des volontaires du service de nettoyage du couvert, du couloir, des douches, des toilettes. Vu le peu d’activités offertes par l’établissement, les personnes se désignent assez facilement.
Les dix-sept premiers jours de mon internement, je ne peux pas sortir du pavillon. On m’informe que c’est un règlement imposé par la sécurité sociale. Il en est de même pour l’accès au service, pompeusement appelé d’ergothérapie, et possédant uniquement des feuilles, des crayons de couleurs et des feutres ( ce service se trouvant pourtant dans le pavillon).
Les personnes internées
Huguette passe ses journées à faire des va-et-vient dans le couloir en prononçant "lon lon, lon lon, lon lon..." en fixant un point imaginaire.
Roger pousse une sorte de chariot, qui lui permet de se maintenir debout et de marcher. Il porte un casque afin de ne pas se blesser lorsque son crâne frappe le mur. Il prononce parfois des onomatopées, son seul langage.
Mao, comme son nom l’indique, pense être Mao, et tient à être appelé seulement par ce nom là, de plus, sa tenue s’y prête. Lorsqu’il dit bonjour, il joint ses paumes, s’incline légèrement "à la chinoise". Il a du mal à s’exprimer, et prononce surtout :
-" C’est moi Mao."
Catherine prie toute la journée au milieu du couloir, à genoux.
J’écoute au début ce qu’elle dit. Ses paroles sont des extraits des versets de la Bible qu’elle connaît par coeur, qu’elle récite avec un rythme musical. Entre les versets, elle insère souvent des phrases du type:
- " C’est elle qui m’a fait du mal - Il ne fallait pas m’étouffer - Cela me tue - Je suis morte."
Charles parle très doucement de peur d’être entendu. Il m’explique qu’il a un micro dans le thorax et qu'il est espionné par le K.G.B : après tout, c’est sa manière de voir.
C’est une personne très intelligente; il est remarquablement doué pour les échecs, auxquels il commence à m'initier. Il me donne également des cours sommaires de géométrie et de mathématiques qui me passionnent.
Je lui annonce que j’ai trouvé la quadrature du cercle. Il me sourit, l’air de dire, "Bah, ma petite, ça te passera".
- " Viens, je vais te la dessiner", lui dis-je, convaincue de ma découverte
:
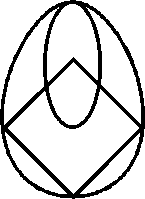
- "Si on cherche la quadrature du cercle à partir du cercle, on ne peut pas la trouver puisqu’il symbolise la perfection. En fait, l’ellipse est beaucoup plus importante : l’orbite des planètes est elliptique, la terre n’est pas vraiment ronde. C’est l’anamorphose du cercle. On est tous distordus, enfermés ou pas, tous pris dans cette anamorphose d’un idéal que l’on a de l’humain. Par analogie, le carré devient losange. Si on trace la circonférence à partir de chaque extrémité du losange et de l’ellipse, on obtient la forme d’un oeuf. La quadrature du cercle est cet enfermement, cet état foetal et léthargique dans lequel on essaie de nous confiner. Ce qu’il faut, c’est prendre la tangente, surtout pas la diagonale. Si on entre dedans, on se fait avoir, prisonnier. "
- " Oui, je sais, la diagonale est dangereuse."
Puis il me glisse à l’oreille :
- " Il ne faut pas que tu restes là, ils te feront du mal."
J’ai surtout sympathisé avec Michel. Les premiers jours, je le voyais uniquement demander des cigarettes, ou prostré sur un chauffage, la bouche ouverte.
Chaque jour, je parle un peu plus avec lui. Au bout d’une semaine, il se met à parler pendant des heures sans discontinuer et me pose parfois des questions.
Il m’informe qu’il est espagnol, me décrit ce pays et les différents métiers qu’il a pratiqués. Je le fais rire souvent, et très vite, nous devenons inséparables. Les infirmières s’étonnent :
- " Ils parlent maintenant ! Comment as-tu fait ?"
Je leur réponds qu’au lieu de regarder la télé, je préfère être avec les personnes qui m’entourent.
J’ai vécu avec lui une expérience qui me parut singulière étant donné que j’ignorais auparavant qu’elle put exister :
Il était assis sur une chaise, dans la pièce commune. Je me suis installée à côté de lui. Il me fixait, la bouche ouverte. Il resta un certain moment dans cette attitude, sans bouger. Alors je décidais de le fixer de la même manière, en ouvrant la bouche. Je sentis un plaisir viscéral qui se communiqua à tout mon corps. Cette découverte sensitive se renouvela à plusieurs reprises, toujours dans les mêmes conditions et fut à chaque fois plus forte. La situation non-verbale me fit comprendre que l’échange de sensations était manifeste. Je vivrai ce même type d’échange plus tard dans la clinique d’Epinay-sur-Seine.
Assez vite, je m’habitue aux médicaments, ce qui me permet de retrouver une certaine énergie pour mettre en rage la psychiatre et certains infirmiers que je n’apprécie pas. Je leur lance des invectives sur leur façon de travailler qui me paraît absurde.
Aucune chaleur ne se dégage d’eux. On sent qu’ils attendent la fin de la journée, la plupart du temps traînant dans la salle des infirmiers.
Notre repas est "expédié", le leur dure au moins une heure et se prolonge tant qu’une remarque d’un patient ne leur signale pas que quelqu’un a un problème ou qu’il y a un conflit. Qu’on ne s’inquiète ! La piqûre est là pour enrayer toute perturbation de leur rythme. La télévision est également toujours allumée dans leur local. Des revues féminines sont étalées sur la table.
Dans le parc, différents cafés où l’on vend des boissons sans alcool et des friandises sont installés. Les bars sont tenus par des patients. Ce sont des lieux de rencontres, de jeux de cartes, de rixes parfois. Excepté l’alcool qui manque dans les verres, on pourrait se croire dans n’importe quel café. Le comportement des patients n’est pas le même dans l’établissement asilaire proprement dit et dans les cafés du parc. Ils me paraissent plus alertes, plus bavards. Je retrouve également des réflexes que j’avais oublié lorsque j’étais enfermée dans l’hôpital.
Dans quelle mesure, la présence du personnel soignant, leurs a priori sur la santé mentale la personne internée, n’influence-t-elle pas le comportement de celles-ci dans les pavillons ?
Des échanges verbaux se manifestent de tables en tables. Des affinités se créent. Des discutions sociales se mettent en place. De quatorze heures à dix-sept heures, une vie communautaire se forme de bar en bar. Des échanges concernant tout type de sujets s’amorcent, ce que je n’entends jamais dans le pavillon, ce lieu étant celui du silence, des va-et-vient dans le couloir, celui où l’atmosphère conditionne tout un chacun, et réciproquement.
Certaines personnes ne sortent jamais dans le parc. La plupart sont celles qui ont des difficultés à marcher où qui restent dans un mutisme chronique. Toute une partie de la population du pavillon (appelé sans ironie "Germinal") est confinée entre quatre murs éclairés au néon, tous les jours de l’année. Lorsque je demandais à une infirmière pour quelle raison tout le monde n’avait pas le droit de sortir dans le parc, elle me répondit :
- "Ils ne peuvent pas.
- "Est-ce qu'ils ont eu déjà le droit de sortir ?"
- "Non, ils ne peuvent pas."
J’admire la haute psychologie de cette institution qui sait d’avance si quelqu’un est apte à sortir où non dans le parc, avant d’avoir fait des essais. Sans doute, certains patients n’auraient pas désiré changer de cadre, d’habitude, de rituels; Mais combien auraient pu y prendre goût, même si cette liberté n’en est pas moins illusoire ?
Dans le parc s’élève un bureau de tabac, tenu par un salarié. C’est le lieu le plus fréquenté étant donné la consommation massive de cigarettes de la plupart des patients. C’est également un lieu social, où l’on peut s’asseoir sur une planche de bois fixée au mur. Dans ce lieu des discussions s’animent, puis s’éteignent souvent, la porte franchie. Des banalités d’usage sont parfois échangées, sur le temps, l’hôpital. Le temps, sujet tellement anodin dans la vie courante n’apparaît généralement jamais à l’intérieur de l’hôpital. Comment parler d’un détail relatif à l'extérieur, lorsqu’on est enfermé à l’intérieur ? De plus, ici personne ne s’encombre à colmater des silences par des paroles vaines, puisque celui-ci est parfois plus supportable que le verbiage de l’extérieur.
Il existe deux cabines téléphoniques près de la sortie du parc. Un jour, m’y rendant, je vois la barrière se lever. Le gardien est tourné dos à moi.
Je fuis l’hôpital, sans me retourner, vers une direction opposée à l’angle de vue du gardien. Je marche peut-être une heure, retournant mon chapeau ainsi que mon blouson en songeant, "A l’envers, on ne peut pas me reconnaître, allant vers autre chose, on ne peut pas me reconnaître."
Je partais, la peur au ventre, sachant que le signalement de mon départ pouvait être donné à n’importe quel moment.
Apercevant un taxi, je lui fais signe de s’arrêter. Je précise au chauffeur que je n’ai pas d’argent mais que s’il peut m’avancer dans sa direction, cela m’arrangerais. Il me fait monter sans formalité et me dépose près d’une station de R.E.R proche de Paris. Ce que je désire, c’est fuir la capitale. Je vais jusqu’à la gare de Lyon, où je prends le premier train. Dans le T.G.V, un contrôleur me dresse une contravention, regardant d’un air surpris mes habits retournés.
Arrivée à Lyon, je marche toute la nuit dans la cité familière, ne contactant personne, errant simplement pour le plaisir de retrouver la marche, la ville, sans les néons, les médicaments, l’atmosphère oppressante. Le Tersian perd de son effet sédatif, et une euphorie, une énergie enfouie depuis trop longtemps renaît.
Je me guide dans la ville par rapport à ses panneaux. Il y a un sens interdit ? Je le prends. Si une flèche indique une direction, je prends la "tangente".
Aller à l’envers, penser à l’envers, tel me semble toujours être la solution pour être protégée, mais surtout pour essayer de comprendre les êtres qui m’entourent, le mécanisme inhérent à chacun, qui nous fait agir, cet indicible qui me hante et que je ne peux définir.
Dans une librairie, je dérobe un livre sur le Dalaï-Lama et un autre sur le risible et le dérisoire.
J'erre plusieurs jours, puis me dirige chez une amie qui ne me reconnaît quasiment pas, aussi bien physiquement que moralement. Je lui raconte ma situation. Elle se précipite vers le téléphone, appelle mon père.
Je me retrouve assez rapidement enfermée à l’hôpital de Perray-Vaucluse, avec cette fois-ci, l’interdiction absolue de sortir dans le parc et l’obligation expresse de rester en pyjama. Je ne reçois aucune visite, aucun appel téléphonique. J’apprendrai plus tard, que la psychiatre avait interdit tout moyen de communication entre les personnes "de l’extérieur" et moi.
Je suis installée dans une chambre à barreaux, où l’on peut m’enfermer. Je reçois des doses massives de neuroleptiques par intraveineuse et ne peux sortir qu’au moment des repas.
Sachant que si je ne m’empêche pas de lancer des réflexions corrosives dans ces moments-là, je resterai encore longtemps dans cette chambre, je me tais. Je n’ai d’ailleurs plus l’énergie et plus l’envie de réagir. J’attends de sortir, mais quand ?
Finalement, quelques jours plus tard, on me donne un lit dans une chambre de trois personnes. Je discute avec l’une de mes voisine qui est là depuis vingt ans.
- "Si je connaissais des personnes, si ma famille venait me voir, je suis sûre que je serais partie d’ici depuis longtemps. Quand on est seul, on a vite fait de nous oublier. Et ici , c’est toujours la même chose, on devient fou pour de bon.".
Je la crois aisément.
Du fait de mon rapport conflictuel avec la psychiatre, j’aurais également pu rester longtemps à Perray-Vaucluse, si mon père n’avait pas réussi à me faire changer d’institution.
Je pars de cet hôpital en ambulance, et arrive à la clinique d’Epinay-sur-Seine.
Ces deux lieux sont radicalement différents. Le côté archaïque de Perray-Vaucluse ressort davantage. Il est vrai que ce dernier est un hôpital public alors que la clinique d’Epinay-sur-Seine est privée, elle a donc plus de moyens. Elle est par ailleurs moins sociale dans son fonctionnement. A Perray- Vaucluse, différents objets étaient fournis, pantoufles, savon, shampooing, chaussures de tennis, rasoirs. Il m’a d’ailleurs semblé étonnant que des rasoirs soient distribués avec une telle facilité, étant donné la fréquence des automutilations en institution psychiatrique.
La clinique est divisée en plusieurs pavillons, deux mixtes, un réservé aux hommes, un réservé aux femmes. Ces deux derniers sont dotés d’une cour intérieure pour les personnes ayant l’interdiction formelle de sortir dans le parc.
Ces deux pavillons accueillent également des "nouveaux arrivés" qui n’ont pu obtenir de place ailleurs. Ce sont donc, aussi, des lieux de transition.
La période précédant la sortie définitive d’un patient se situe le plus souvent dans un bâtiment mixte. Ce dernier est généralement un passage obligé, une étape permettant au psychiatre de juger si les gens sont aptes à retrouver une certaine vie sociale, sans le support de l’institution.
Les pavillons non-mixtes, sont par ailleurs des lieux de punition pour les patients des autres bâtiments, ayant commis certaines fautes, selon les critères de la clinique : possession d’alcool, de stupéfiants, preuves de rapports sexuels, sont les cas les plus fréquents.
Un atelier d’ergothérapie, où il est possible de sculpter, faire du modelage, de la peinture et autres activités est dans le parc. Un prêt de livre existe également, ainsi qu’un piano.
Contrairement à l’hôpital de Perray-Vaucluse, il est possible, ici, de sortir dans le parc, les dix-sept premiers jours et le port du pyjama n’est nullement imposé dans la journée, durant cette période.
Je commence mon séjour dans "le pavillon des dames "qui, si pour d’autres est un lieu de punition, me paraît nettement plus agréable que le bâtiment de la précédente institution. Une chaleur se dégage des infirmières, et il est possible de dialoguer avec elles. Ceci est en parti dû au fait que leur local est plus petit, moins agencé pour une vie autonome, et qu’il n’y a pas de télévision.
Hormis une femme prostrée sur le sol en position quasi-foetale, les personnes internées le sont depuis moins de cinq ans. Il est visible que les doses de médicaments sont distribuées de façon moins massives qu’à Perray- Vaucluse.
Le fait que les patients soient souvent enfermées depuis moins longtemps, n’est pas l’unique raison (les états de torpeur et d’abrutissement survenant assez rapidement après l’internement, à l’hôpital). Pour la même pathologie, je ne suis pas traitée ici avec des neuroleptiques.
Plusieurs personnes relativement jeunes à Perray-Vaucluse étaient atteintes de maladie de Parkinson (tremblements). Cela s’explique par le fait que des antiparkinsoniens palliant aux effets secondaires des neuroleptiques ne leur étaient pas distribué, contrairement à la clinique.
Ce moindre mal, ne m’empêche pas de m’échapper de la clinique, au bout de deux jours et de retourner, finalement de mon plein gré, après plusieurs jours d’errance, songeant qu'il valait mieux finir mon séjour, sans être obligée de me cacher, pour éviter que l'on me retrouve. Paradoxalement, je ne réintègre pas le "pavillon des dames", généralement considéré comme une punition. Le psychiatre ne m’interdit pas non plus les sorties dans le parc, décidant "de me faire confiance."
J’intègre un pavillon mixte, et passe la plus grande partie de mon temps dans l’atelier d’ergothérapie, me consacrant au modelage, et à la peinture.
Honnêtement, une personne désireuse d’assistanat, prendrait presque plaisir à rester ici, sachant qu’au bout de dix- sept jours, il est possible de sortir de la clinique, l’après-midi.
Après avoir demandé au psychiatre, s’il était possible d’avoir une autorisation pour assister aux cours d’ethnométhodologie, le jeudi soir, il me donne son accord.
Autant l'atmosphère à l'hôpital était austère, autant à Epinay, étions-nous un groupe à "faire la fête", beaucoup trop au goût des psychiatres et des infirmiers, ainsi que pour certains patients qui nous signalaient que nous n'étions pas "en vacances Sécu."
Ce que nous voulions, c'était échapper à l'idée que nous étions en institution psychiatrique, effectivement. Nous profitions au maximum, de la liberté relative qui nous était accordée, outrepassant les limites plus d'une fois.
Nous repérions qui était le personnel de nuit. Et selon les infirmiers nous organisions des stratégies différentes pour ce coucher le plus tard possible.
Nous savions, pour l'avoir remarqué, que deux des infirmiers qui faisaient toujours leurs garde ensemble, après leur ronde de dix heures, s'endormaient profondément, alors qu'ils étaient sensés restés toujours en éveil. On pouvait les voir dormir, l'un dans la salle des infirmiers, derrière la porte vitrée, l'autre allongé sur un matelas dans la salle à manger.
On peut constater que les interdits, quelque soit l'âge, avaient tendance, dans ce cas précis à nous créer des attitudes d'adolescents, qui plus que le plaisir de veiller tard, qu'il procurait, devenait parfois un jeu.
Dés que nous avions vérifié que les infirmiers dormaient, nous discutions ou faisions des parties de cartes jusqu'à trois-quatre heures du matin. Même si nous étions un peu bruyants, nous ne dérangions manifestement pas les autres patients, qui prenaient des somnifères pour la plupart.
Les infirmiers, de leur côté, dormaient au rez-de-chaussée, alors que les chambres se trouvaient dans les étages.
Des couples se sont formés parmi toutes les personnes du groupe, et nous fûmes plus d'une fois surpris à deux dans le même lit. Nous n'avons pas tardé à avoir la réputation de "bordel organisé" de la part d'autres patients qui nous regardaient d'une manière méprisante, certains allant jusqu'à dire que nous étions possédés par le mal. Une patiente d'origine algérienne me dit que je déshonorais les femmes de notre race. Sur quoi je répliquais que la sexualité existe bel et bien, qu'on soit honnête ou hypocrite à son égard.
Le personnel soignant décida de prendre des mesures pour nous séparer, et nous menaça, si nous récidivions d'être envoyés dans des pavillons non-mixtes, moi surtout qui étais considérée comme étant "l'élément déclenchant de cette anarchie", car avant que je n'arrive, "tout était très calme". Ces décisions ne changèrent en rien notre attitude.
Finalement, un psychiatre du pavillon des hommes réputé pour son autorité et sa vigilance extrême, vint pratiquement tous les soirs à notre pavillon, ce qui effectivement remit un peu de discipline, mais entravait peu notre désir de liberté, ou plutôt notre esprit de contradiction.
Finalement, lassée par ces festivités relatives, je décidais de mettre fin à un comportement jugé "provocateur et déstabilisant pour les autres patients" (dixit une psychiatre, souhaitant m'imposer l'administration de neuroleptiques, lors des jours de congés du psychiatre qui me suivait). Je fut libérée, peu après avoir cherché et trouvé une chambre de bonne. Un processus de resocialisation se mit en place.